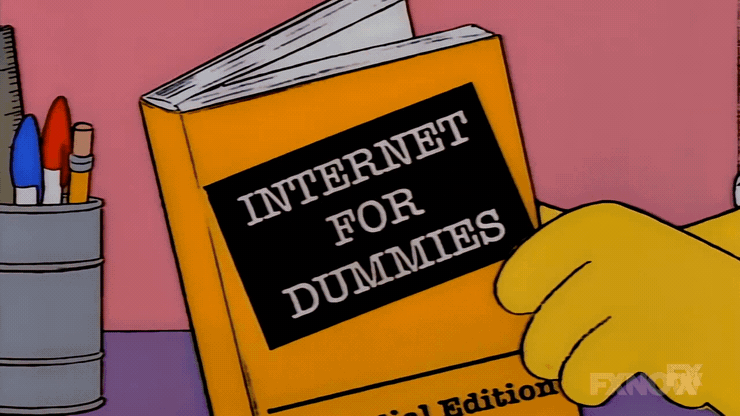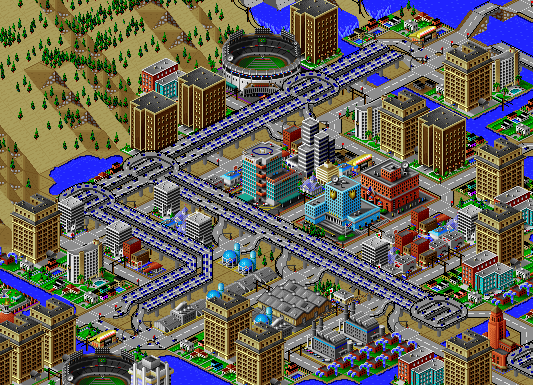L’acronyme “GAFA” est-il vraiment pertinent ?
GAFA par-ci, GAFA par-là : on ne peut plus trouver un article traitant de numérique sans tomber sur cet acronyme désignant Google, Apple, Facebook et Amazon. Gageons que vous pourriez même tomber dessus en cherchant, par exemple, un article sur Gaston Lagaffe. Mais cet acronyme a-t-il vraiment un sens ?
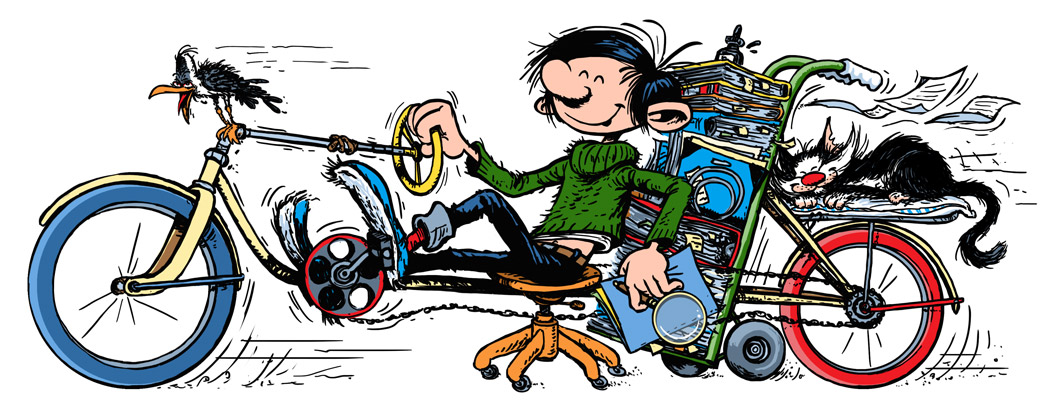
Évidemment, les GAFA ont un point commun qui saute aux yeux : si vous détenez des actions chez eux, vous êtes riches – les GAFA font partie des premières capitalisations boursières mondiales. Ce sont par ailleurs des sociétés de tech relativement jeunes (Facebook, la plus jeune, a tout juste l’âge de se créer un compte sur son propre réseau – 13 ans – tandis qu’Apple, la plus vieille, vient de dépasser la quarantaine). Mais au-delà de ce pur aspect capitaliste, force est de constater, à l’instar de Numerama, que les GAFA diffèrent singulièrement les uns des autres.
Ainsi, Google n’est plus Google mais Alphabet, et cherche à diversifier grandement son business model basé jusqu’à alors exclusivement sur la pub, ce qui lui fait un point commun avec Facebook, mais pas plus. Apple reste une entreprise de hardware malgré ses quelques logiciels à succès, et Amazon un e-commerçant, dont les publicités servent à générer des achats sur sa propre plateforme. Comparer Google (réduit au moteur de recherche) et YouTube et Facebook a un sens, mais rajouter Apple et Amazon dans la boucle n’en a que peu. Par ailleurs, le sigle oublie complètement l’un des principaux acteurs de la tech, qui existe au sommet des capitalisations boursières depuis belle lurette et dispose de synergies avec l’ensemble des acteurs sus-cités : Microsoft. On voit ainsi se rajouter régulièrement le M de Microsoft pour donner GAFAM : si les business models des uns et des autres restent très différents (et d’ailleurs pas forcément liés directement au développement d’Internet pour Microsoft et Apple), il n’en reste pas moins qu’on englobe les plus grandes capitalisations boursières de la tech.
Reste que s’il s’agit de parler de l’évolution d’Internet en tant que technologie, le sigle est largement insuffisant : on met ainsi de côté le développement faramineux des “NATU” (Netflix, Airbnb, Tesla et Uber), et surtout la croissance phénoménale de l’Internet chinois avec ses “BATX” (Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi), dont certains font désormais également partie du club des dix premières capitalisations boursières de la planète. Au fond, parler de “géants du net” permet de faire facilement référence aux entreprises extrêmement puissantes qui se partagent un oligopole sur les différents marchés d’Internet, tandis que les acronymes de noms de sociétés conservent un sens lorsque l’on traite de géopolitique. On privilégiera donc une utilisation modérée du sigle GAFAM, à n’employer qu’à bon escient.
 Shower Thoughts
Shower Thoughts