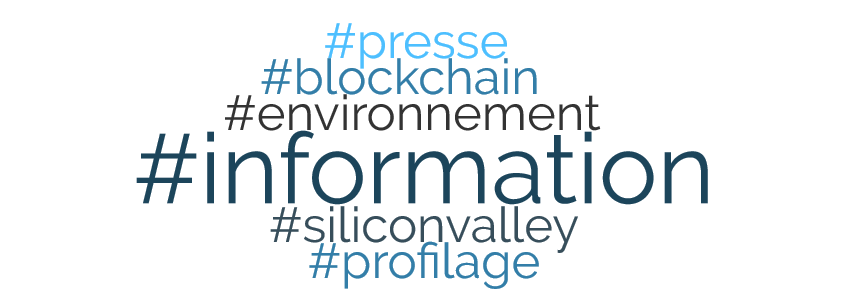Et si tous les grands événements de l’Histoire n’étaient que mensonges martelés par l’État pour nous maintenir dans une confortable et béate attitude d’obéissance ignorante ? La Terre est plate, l’Homme n’est jamais allé sur la Lune, et le 11 septembre a été commandité par les États-Unis, et ceux qui découvrent ces vérités sont comme Neo : ils sont capables de voir les bugs dans la matrice.
Complot ou fake news
La promesse des débuts d’Internet était que le réseau allait permettre à l’humanité de partager plus aisément contenus, pensées, culture. C’est le cas, mais le web permet tout aussi aisément de partager infox (pour utiliser le terme consacré) et théories complotistes. Le Monde montre ainsi cette semaine comment Netflix, Amazon Prime et les autres sites de streaming, qui sont donc censés sélectionner leurs contenus, sont tout aussi accueillants pour les contenus conspirationnistes que ne l’est YouTube, hébergeur. Internet est ainsi vecteur de la propagation quasi instantanée de tous types de contenus, sans discriminer, ce qui peut avoir ses désavantages quand la ligne entre opinion complotiste et fake news devient ténue.
C’est en effet grâce à la rapidité de diffusion de l’information et à la tendance à ne lire que le titre de l’article (c’est pour ça que nos titres de Maj sont si cryptiques) et à ne pas vérifier systématiquement les informations communiquées que les fake news se diffusent, leur plus grande différence avec les contenus conspirationnistes étant que ces dernières ont pour but de semer le trouble. On pourrait ainsi argumenter que les contenus conspirationnistes ne sont “que” des opinions contredites par la science, mais sans intention de nuire, tandis que la fake news a un caractère intentionnel visant à induire en erreur le public visé. Dans les deux cas cependant, nous sommes invités à repenser la notion de vérité : qui la détient, qui peut s’en porter garant, et surtout, comment éviter, à l’heure de l’instantanéité, que de fausses vérités soient diffusées ?
Liberté ou licence d’expression
Bien sûr, ces débats ne sont pas le propre du monde contemporain : ils ne sont qu’exacerbés par Internet mais existent depuis toujours. In fine, il s’agit bien de se demander comment contrôler la diffusion de l’information, qu’il s’agisse des “vérités alternatives” et autres contenus complotistes ou des contenus censurés par les régimes autoritaires. C’est tout le paradoxe, extrêmement compliqué à gérer effectivement, de la lutte contre les fake news et autres théories du complot : ne pas lutter, c’est prendre le risque que la société n’ait plus la vérité comme valeur, tandis que contrôler la parole, c’est très rapidement tomber dans la censure.
Le seul moyen de se défaire de ce paradoxe est d’accepter que la liberté totale d’expression, celle de la parole sans bride, n’est en fait qu’une licence d’expression, au sens kantien du terme : seule une véritable liberté d’expression peut permettre de résoudre notre problématique, à savoir une liberté qui s’exprime dans le cadre de règles consenties qui délimitent la voie au sein de laquelle l’on peut agir délibérément. C’est pourquoi l’injure, la diffamation, le harcèlement, les incitations à la haine, à la discrimination ou à la violence, ou encore les propos négationnistes sont interdits en France : nous avons de longue date adopté une liberté d’expression conforme à l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Reste à voir comment définir le contenu complotiste ou la fake news sans tomber dans la censure : qui a dit que l’on pouvait résoudre le paradoxe facilement ? Nous ? Prouvez-le !
Ce qu'on lit cette semaine
#presse
#information
#vieprivée
#cedh
#droitàl'image
#entrelesmurs
Nouvelle pierre à l’édifice jurisprudentiel de la Cour Européenne des Droits de l’Homme en matière de vie privée et droit à l’image dans l’univers de la presse. On le sait, la règle en la matière (comme pour tous conflits de droit fondamentaux) est celle de la mise en balance – mise en balance, en substance, entre les droits à l’image et à la vie privée d’une part, et entre la liberté d’expression et le droit à l’information d’autre part. Ceci étant dit, la mise en pratique du schéma n’a rien d’évident, et la Cour ne se prive pas de recourir à une multitude de critères pour déterminer si d’abord atteinte il y a, et ensuite si celle-ci est condamnable car non proportionnée. En l’espèce, statuant sur une condamnation d’un organe de presse allemand à retirer la photo d’un présentateur télé faisant apparaître ce dernier dans la cour d’une prison, dans le cadre de sa détention préventive, la Cour s’attache tout particulièrement au critère des “attentes légitimes” de la victime de l’atteinte – elle considère, en somme, que cette dernière ne pouvait pas s’attendre à être prise en photo à cet endroit, nonobstant sa notoriété. Elle rappelle par ailleurs, contre la décision allemande cette fois, que le juge du fond ne peut opérer qu’un contrôle réduit quant aux illustrations de presse, le journaliste restant notamment seul arbitre, en principe, de l’opportunité d’agrémenter son texte d’une photo illustrative, sous réserve que celle-ci présente un minimum de lien avec ce texte.
#siliconvalley
#capitalrisk
#c'estpasdujeu
Le japonais Masayoshi Son est à l’écosystème de la tech ce que les Qataris sont au football : ceux qui peuvent tellement investir que c’est limite plus drôle. Vous ne le connaissez peut-être pas mais il est la 39ème personne la plus riche du monde (22,7 milliards) et le CEO du conglomérat de telecom japonais SoftBank. Mué par une sorte de feu sacré, Son dit avoir un plan pour le futur de la tech sur les 300 prochaines années, plan qu’il a commencé à mettre en place en 2016 à travers le SoftBank Vision Fund, un fonds d’investissement doté d’un capital de 100 milliards et dont le ticket minimum est de 100 millions (oui oui c’est des gros montants) spécialisé dans les nouvelles technologies. Et, ce plan réside quasi exclusivement dans le développement de l’IA. C’est ainsi que le Vision Fund place ses billes dans tout ce qui peut développer ou assister les algorithmes avec des participations notamment dans WeWork pour l’automatisation de la gestion de l’immobilier ou encore Light pour sa fabrication de caméras 3D qui équiperont les voitures autonomes. Portrait d’un homme qu’il est recommandé de lire pour savoir comment l’on passe de l’admiration d’un ronin (samouraï sans maître) à prévoir la singularité à l’horizon 2040.
#blockchain
#smartcontracts
#makingbigdecisions
Combien faut-il d’utilisateurs pour changer une blockchain ? La question ressemble il est vrai à une blague d’ingénieurs – et pourtant, elle interroge le principe même de ces nouveaux objets techniques et sociétaux que sont les blockchains. Témoin le cas d’Ethereum, dont les premiers temps avaient déjà été marqués par une épineuse hard fork, à l’occasion d’un “vol” massif de cryptomonnaie, cause d’un important débat interne à la communauté : le scénario se répète aujourd’hui à l’abord d’une fork délibérée cette fois, liée à la volonté de certains utilisateurs “leaders” d’améliorer l’infrastructure du système décentralisée. Comment donc s’écrit l’histoire d’une blockchain ? Qui décide d’un changement technique, ou de l’annulation d’une opération ? La réponse technique est (relativement) simple : c’est la majorité qui décide. Sociologiquement, l’explication l’est beaucoup moins : qui prend l’initiative de proposer la modification ? Comment l’idée de celle-ci se répand-elle pour gagner l’assentiment général (ou pas) ? Il y aurait là toute une discipline à construire, sans doute. C’est que (comme le souligne l’auteur de cet article) la décentralisation parfaite et absolue, promise par les thuriféraires de la blockchain (publique), n’est probablement pas de ce monde ; il faudra donc suivre de près les suites de cette fork, révélatrice des interrogations fondamentales de la blockchain comme “micro société”.
#profilage
#algorithme
#vieprivée
#internet
#publicitéciblée
#memyselfandi
Quelle est la portée pratique réelle de l’obligation d’information en matière de données personnelles ? La question est l’objet d’un débat au long cours, qui conduit certains à fustiger l’informed consent fallacy, c’est-à-dire à dénoncer comme fausse l’idée selon laquelle il serait possible d’obtenir d’un individu un consentement réellement libre et éclairé en matière de vie privée. Sans aller jusqu’à cette extrémité, on peut du moins tirer une conclusion intéressante en ce sens de l’étude statistique expliquée dans cet article : la majorité des utilisateurs réguliers de Facebook aux Etats-Unis ignorent l’existence même du profilage publicitaire par catégories opéré par le réseau social sur la base de leur navigation. Autre donnée intéressante : l’acceptabilité de ce profilage semble fortement corrélée à l’exactitude de l’analyse du point de vue des intéressés eux-mêmes ; autrement dit, quitte à grossir le trait : pas de souci à être tracé, pourvu que le profilage soit fidèle. Il y aurait là un argument de choix pour les contempteurs de l’informed consent fallacy, selon lesquels, au fond, nous pourrions bien être les pires défenseurs de notre propre vie privée. Argument à nuancer toutefois : l’étude a été menée, rappelons-le, aux Etats-Unis, où nul GDPR n’est pour l’heure venu imposer les mêmes exigences que dans l’UE, s’agissant de l’information transparente à l’égard des personnes concernées. Si par chez nous non plus tout n’est pas encore parfait, l’actualité jurisprudentielle la plus chaude (côté Belgique) démontre que la culture de la transparence gagne du terrain, tout particulièrement vis-à-vis du réseau social en question.
#environnement
#amazon
#e-commerce
#notamazingamazon
Dimanche de la semaine dernière, l’émission Capital diffusait un reportage sur la destruction à grande échelle de produits invendus. Ce sont ainsi 3,2 millions d’articles neufs qui auraient été détruits au seul cours de l’année 2018. La cause ? La politique de prix proposée par Amazon à ses vendeurs pour que leurs produits soient stockés dans ses entrepôts et qu’ils puissent ainsi être livrés plus rapidement aux consommateurs. Avec un prix d’appel de 26 euros pour trois mètres carrés qui passent de 500 euros après 6 mois et à 1000 après un an, l’équilibre des incitations économiques est assez simple : pour un vendeur, le fait de proposer des délais de livraison très courts signifie que ses produits seront préférés à ceux qui seront livrés plus tard. Si l’augmentation de son chiffre d’affaires attendu de ce fait sur les 6 premiers mois est supérieure au coût de stockage et à celui de la surproduction éventuelle, l’opération est rentable même si le surplus de marchandise est détruit. Côté Amazon, l’on remarquera simplement qu’elle a intérêt à libérer du mètre carré et qu’elle ira au moins couteux, même si cela signifie détruire plutôt que recycler ou retourner. Une belle illustration de ce que les problématiques environnementales sont pour les acteurs économiques, malheureusement, des externalités négatives.