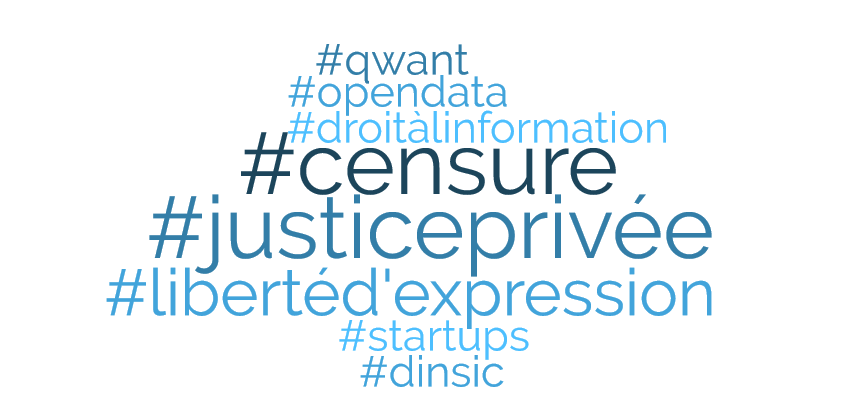Comme vous l’avez peut-être déjà lu dans ces lignes, nous ne croyons pas à la liberté d’expression incontrôlée comme elle le serait aux États-Unis, où, bien que les injures raciales soient permises, la diffamation, elle, est bien pénalisée. Pour autant, le projet de loi contre la haine en ligne actuellement débattu au Parlement nous semble aussi peu souhaitable que la perspective de n’avoir aucun cadre à la liberté d’expression.
La colère des faibles
“La haine, c’est la colère des faibles… Si j’étais rémouleuse, je me méfierais…” écrit Alphonse Daudet dans les lettres de son moulin. La notion de haine a fait l’objet de maintes études de philosophes et de psychiatres, mais peu de définitions nous semblent toucher le cœur du sujet aussi profondément que celle-ci. On y apprend que la haine est un sentiment, associé par Daudet à une absence de contrôle de soi, qui laisse craindre un passage à l’acte. Cette définition cristallise bien ce qui nous parait si contestable dans le projet de loi contre la haine en ligne : en l’absence de passage à l’acte et de commission d’une infraction (de presse, comme l’injure raciale, ou non), la haine reste une idée, une émotion, dont l’expression ne devrait relever que de ce domaine. Imposer le retrait de discours de haine qui ne relèvent pas d’une infraction, c’est basculer d’une société de la responsabilité (chacun est responsable de ses actes et en répond ex post, en comptant sur cette responsabilité pour que les raisons d’intervenir soient limitées) à une société de la prévention (on recherche l’infraction 0, quitte à déresponsabiliser les personnes et brider leurs libertés). C’est tout le délicat équilibre de la définition de la liberté, qui n’existe que si elle est cadrée, mais qui disparait lorsque le cadre est trop restreint.
Le danger que nous évoquons n’est pas une chimère : en témoigne le déluge d’amendements qui visaient à ce que soient retirés sans autre effort de qualification juridique, entre autres, les discours d’agribashing, d’apologie de l’antisionisme ou encore relatifs à l’apparence physique d’une personne. Il semble que fort heureusement, malgré les pressions de nos parlementaires, seuls des propos faisant déjà l’objet d’une infraction pénale seront concernés par la loi. On en vient ainsi au second, et principal, problème de cette loi : l’obligation de retrait sous 24h. La loi contre la haine en ligne souhaite en effet renforcer les obligations déjà existantes pour les hébergeurs de retirer des contenus manifestement illicites, en imposant aux opérateurs de plateformes (et non plus aux simples hébergeurs) de retirer sous 24H les contenus toujours manifestement illicites, mais relevant de certaines catégories de discours. Les sanctions en cas de non respect peuvent monter jusqu’à 4% du chiffre d’affaires mondial. Outre les risques évidents de surcensure associés à des dispositifs aussi restrictifs, et donc incitatifs à faire plutôt trop que pas assez, c’est l’incitation à la justice privée qui est la plus décriée dans ce texte.
Signé Aeon : notre feuilleton de l’été « Jugé(e) par une plateforme ? Justice privée à l’ère du numérique »
En effet, le texte fait une fois de plus des hébergeurs (et ici, des plateformes, de manière plus générale, alors que les qualifications d’hébergeur et d’opérateur de plateforme se recoupent mais ne se recouvrent pas) les censeurs du manifestement illicite, état de fait que nous critiquions déjà avant qu’il ne soit assorti des conditions, délais et sanctions sus-cités. Les députés ont même fermement rejeté l’idée d’introduire un contrôle ex ante du juge étatique avant décision de retrait d’un contenu. Nous sommes bien face à un choix délibéré du législateur de confier aux entreprises du web le soin de qualifier juridiquement des contenus, et en conséquence, de les maintenir en ligne ou de les retirer.
Il s’agit donc d’une compétence quasi juridictionnelle, que l’on peut qualifier de justice privée, et qui fait écho à d’autres mécanismes de résolution des litiges mis en œuvre par les entreprises du net, comme par exemple le projet de “Cour Suprême” de Facebook ou l’interface de médiation d’AirBnB. Ça tombe bien, ce sujet d’actualité brûlante est celui du feuilleton de l’été que nous vous proposons : une série d’articles explorant cette justice privée dont le développement s’est considérablement accéléré avec le numérique, et ce avant un grand tribunal fictif organisé en novembre prochain avec Open Law. Prêt(e)s à binger ? C’est par ici :
Jugé(e) par une plateforme ? | Épisode 1 : Il était une fois la justice d’Internet
Ce qu'on lit cette semaine
#censure
#plateformes
#libertéd'expression
#société
#àboutdesouffle
Le législateur aurait-il voulu, pour illustrer sa nouvelle obligation de retrait des contenus sous 24h, adopter lui-même sa loi dans ce délai record ? A observer la vitesse de progression de la proposition portée par la députée Avia, on se poserait presque la question. On regrettera que cette marche forcée se joue au détriment de la qualité d’un texte qui n’en finit plus de susciter, tour à tour, consternation, angoisse et colère, et réussit le tour de force de ne satisfaire personne, si ce n’est (semble-t-il) les parlementaires eux-mêmes. C’est que les obligations qu’ils prévoient, déjà peu lisibles et mal circonscrites dans leur version initiale, ressortent de l’Assemblée Nationale en la forme d’un paquet “fourre-tout”, probablement inapplicable en l’état. Il y a dans cette fuite en avant la désagréable impression d’une faillite globale – faillite démocratique, quand le législateur n’en fait plus qu’à sa tête ; faillite juridique, quand l’exercice de qualification rigoureuse semble être devenu un luxe ; faillite technique, enfin, quand la réalité de la modération des contenus paraît complètement échapper à ceux-là même qu’elle devrait préoccuper. Tel serait donc l’esprit de l’époque ? Il est encore temps de s’inscrire en faux.
#libertéd'expression
#haine
#USA
#censure
#france
#causetoujours
Nous voici donc arrivés au point où nous sommes tout juste bons à recevoir des leçons de liberté d’expression de nos voisins américains. C’est du moins ce que voudrait affirmer l’auteur de cet article (états-unien, comme on s’en doute), non sans quelque dose de mauvaise foi aux entournures ; et pourtant : il est vrai que la France, qui se targuait encore récemment, tout juste sortie de sa gueule de bois post-Charlie Hebdo, de faire rayonner dans le monde entier l’esprit des Lumières, avec ce qu’il implique de provoc’ et de parfois désagréable, semble aujourd’hui avoir la censure prompte et la liberté en berne. Que s’est-il donc passé ? Les attentats eux-mêmes, à l’évidence, deux coups de boutoir dans notre cohésion nationale ; plusieurs drames racistes et antisémites, aussi ; la flambée de certains discours de défiance anti-démocratique, enfin – il n’en aura pas fallu beaucoup plus pour tenter de mettre Internet au pas, en l’attrapant par ses plus grandes plateformes. Avec cet effet quelque peu ironique, dénoncé par l’auteur de cet article, que nous allons peut-être ainsi parvenir à battre les Etats-Unis avec leur arme fétiche – l’extraterritorialité de fait. On eût préféré, à tout prendre, que cela se joue sur d’autres terrains.
#startups
#dinsic
#républiquenumérique
#finidepantoufler
Et si c’était là qu’elle se trouvait, la startup nation ? Pour faire taire le hiatus entre une politique volontariste en matière de numérique et une administration publique toujours prisonnière de ses clichés (hostilité au changement, priorisation de procédures inutilement complexes, absence de culture numérique), l’Etat cultive depuis 2013 une série de jeunes pousses dans le cadre de l’incubateur Beta.gouv, rattaché à la Direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication de l’État (Dinsic). Objectif ? Internaliser la transition numérique, via ses méthodes de travail, sa culture et ses talents, et créer ainsi des outils et services adaptés aux besoins de l’usager, dans le sens d’une plus grande efficacité. La promesse est grande et s’est déjà matérialisée dans les réalisations de quelques “startups d’Etat” dédiées à améliorer les relations, par exemple, entre Pôle Emploi et les administrés concernés. Si les budgets et les projets restent somme toute modestes en comparaison de ceux que peuvent atteindre le secteur privé, on ne peut que saluer le bilan (provisoire) de l’initiative, qui tend à combler le retard pris par la France en la matière.
#dinsic
#administration
#transformationnumérique
#legrandménagedeprintemps
C’est une sorte de révolution de palais, et un peu plus que ça à la fois : la transformation de la Direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication de l’État (Dinsic) en Direction interministérielle au numérique (Dinum), doublée, par-delà le changement d’acronyme, du départ de son directeur historique Henri Verdier, et d’une reconfiguration de ses attributions, laisse comme un goût de doute au sein de ses collaborateurs. C’est que le successeur au poste, Nadi Bou Hanna, n’a pas encore suffisamment affirmé sa vision et sa feuille de route pour y parvenir ; c’est aussi que le changement de modèle d’organisation, qui fait passer l’organisme de pilote à coordinateur d’une série de directions du numérique réparties auprès de chaque ministère, s’accompagne d’incertitudes légitimes sur la capacité à continuer à mobiliser et pérenniser des projets jusqu’ici prometteurs. Gageons que l’on en sortira par le haut – il serait regrettable que la logique administrative mette à mal de beaux efforts en la matière.
#opendata
#avocats
#décisionsdejustice
#anonymisation
#lagrandemuette
Aura-t-on un jour seulement le droit de lire des décisions de justice complètes ? Le mouvement d’open data initié par la loi République Numérique, que soutenait à l’époque le Conseil National des Barreaux, semble en tous cas aujourd’hui en régression complète ; témoin cette récente prise de position du même CNB, demandant à ce que les noms des avocats soient occultés des décisions publiées dans les mêmes conditions que ceux des magistrats. On ne peut s’empêcher de voir là, bien sûr, une contradiction flagrante du principe de publicité de la justice, dont les avocats sont, après tout, rappelons-les, des auxiliaires parmi les plus essentiels. Ici comme ailleurs, on s’interroge, du reste, sur les raisons profondes de telles craintes qui conduisent à exiger l’anonymat comme garantie, et l’on regrettera de voir, à nouveau, la France se placer seule au devant de positions aussi peu favorables à la transparence et au droit à l’information du public. A quand, peut-être, un signal plus optimiste de l’Union Européenne ?
#qwant
#souveraineténumérique
#moteursderecherche
#lâgeingrat
Que faut-il donc penser de Qwant ? Celui qu’on présentait il y a encore quelques années comme le futur premier moteur de recherche européen, alternative souveraine et privacy-friendly à Google, peine de plus en plus à convaincre… mis à part l’Etat, qui affirmait lors du dernier salon Vivatech, par la voix de son secrétaire d’Etat chargé du numérique, vouloir en faire le moteur par défaut de l’ensemble des administrations françaises. En attendant, la peut-être prochaine licorne nationale continue de souffrir de pertes croissantes, et de polémiques répétées, nées de contradictions identifiées entre son discours marketing et la réalité de ses pratiques. Pour une large part techniquement dépendante de son pourtant concurrent direct Microsoft (à travers le moteur Bing et le service Bing Ads), Qwant semble ainsi éprouver quelques difficultés à trouver des moyens à la hauteur de ses ambitions – qui devraient pourtant nous être communes à tous, tant la souveraineté numérique est un enjeu contemporain majeur. Dernière porte pour sortir de ce marasme : un contrat de déploiement avec l’Etat, doublé d’une importante levée de fonds… Affaire à suivre.